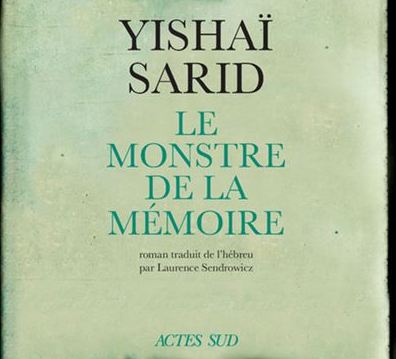Peut-on consacrer sa vie à la vie à la Shoah? A l’énumération de noms comme Raul Hilberg, Yehouda Bauer ou Israel Gutman, la réponse est affirmative.
Pour l’antihéros de ce court récit, il s’agit toutefois d’un choix par défaut, motivé par l’abandon d’une carrière diplomatique mais imposé par le statut d’historien israélien restant désormais au pays. La nécessité de se départager de la littérature existante concentre la recherche sur la comparaison des moyens d’extermination en fonction des différents camps.
Débutant comme une lettre au Père, dont on attendrait soutien, reconnaissance et pourquoi pas admiration, cette confession pudique s’adresse non pas à un géniteur mais à une fonction symbolique chargée d’autorité: le président de Yad Vashem.
Le parcours d’un historien lambda comporte des charges pédagogiques qui se résument aux vicissitudes de la fonction d’accompagnateur lors des voyages scolaires emmenant les adolescents israéliens en Pologne. L’indiscipline des classes, la persistance d’une animosité vivace entre les jeunes pousses selon que leur familles soient ashkénaze ou sépharade, l’inculture généralisée, la prévalence d’un sentimentalisme victimaire au détriment d’une vraie connaissance historique, le cérémonial des drapeaux israéliens le long de la rampe à Birkenau, l’arrogante expression d’une identité inféodée à la valorisation de la force , de la lutte, dans le mépris souverain de la culture européenne, tous ces éléments amènent le narrateur à l’impression d’une faillite éducative sans précédent.
Contacté par des créateurs de jeu vidéo reproduisant à l’identique les plans de Treblinka et soutenant les vertus pédagogiques du projet, l’historien réalise que le digital est le valet d’une économie néo-libérale qui fait feu de tout bois tant qu’il s’agit de conquérir de nouveaux marchés. Dans le combat qui l’oppose à l’image, le mot a définitivement perdu la bataille. L’épuisement progressif occasionné par de multiples allers-retours, entraînant une négligence de soi, rend l’historien intolérant à la phobie scolaire de son jeune enfant, incapable de riposter en classe, à l’agressivité des autres enfants. La gravité de la mission mémorielle entraîne un durcissement psychique qui empêche de prendre en compte les besoins fondamentaux d’un enfant et de ne pas les interpréter de facto comme une marque faiblesse ou une pathologie.
La quasi disparition de la vie conjugale inscrit en filigranes une autre question: que devient l’amour après la fondation d’une famille? Cette fréquentation quotidienne du mal,dans ses aspects les plus techniques en termes d’efficacité exterminatrice, rapproche l’historien du Tsaddiq. Ce dernier, dont la vocation est de libérer les étincelles de sainteté du monde des klipot, se doit de descendre dans l’Autre Côté, tout en étant conscient du danger que comporte une telle entreprise. Car le Mal séduit, fascine, abime, détruit. Le Tsaddiq n’est pas taillé dans l’acier et la Shoah est une des versions les plus monstrueuses de l’Autre Côté.
La rencontre avec un cinéaste allemand mettra sous tension les dernières résistances de l’historien. Le discours affiché vantant le renouveau d’un cinéma national aux prises avec son passé distille des relents de mythes nauséabonds. Réalisant que le cinéaste l’instrumentalise,le réduisant à un esclave utile au service de sa propre promotion, l’historien laissera éclater sa fureur et frappera de ses poings son interlocuteur, rejoignant à son corps défendant le primat de la force qui le rebutait tant dans le discours de son public adolescent.
Dans ce passage à l’acte libérateur, il renvoie à l’Allemand la responsabilité exclusive du Mal, cette jubilation éprouvée dans le rapport de force, poussée à son ultime limite, à savoir la mise à mort. Cette jouissance jumelée au déni de la souffrance infligée, c’est ce qu’on appelle la perversion.
Isabelle Telerman.